L’avenir était quand même mieux avant la fin du monde
L’avenir était quand même mieux avant la fin du monde
Bertrand Louart
Publié en 1972, le rapport du Club de Rome, groupe informel et international composé d’éminents hommes d’affaires, de dirigeants et de scientifiques, intitulé Les Limites à la croissance1 anticipait à l’aide de simulations informatiques les problèmes que posait une croissance économique et démographique sur une planète aux ressources limitées. Il préconisait de « stabiliser » la croissance afin de préserver le système économique mondial d’un effondrement. Il fut par la suite à l’origine du concept de « développement durable » (sustainable development) qui cherche à concilier les aspects économiques, sociaux et environnementaux de l’expansion marchande. Autant essayer de préserver la chèvre et le chou ou le loup et l’agneau des Fables de La Fontaine ! Dennis Meadows, 40 ans plus tard, a bien été obligé d’admettre que tout a continué. Seuls les discours ont changé, faisant passer pour « écologiques » les nouveaux secteurs industriels qui ont émergé suite à la prise en compte des diverses nuisances générées lors des « Trente Glorieuses »2. La collapsologie, « science de l’effondrement » (collapse en anglais) prétend maintenant élever la prophétie de l’effondrement de la société industrielle à la dignité d’une discipline académique. En France, Pablo Servigne et ses coauteurs sont en quelque sorte devenus les prophètes de cette prospective qui se veut scientifique, grâce à la publication de trois ouvrages lancée par Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes chez Seuil en 2015.
Depuis ce livre, ils multiplient les interventions dans les médias pour porter partout la vérité de l’effondrementalisme3 : « la fête industrielle sera bientôt terminée » (selon les mots de l’universitaire Dominique Bourg, vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, dans sa préface au livre Une autre fin du monde est possible). Forts de toutes les données scientifiques qui montrent l’inéluctabilité de l’effondrement, ces auteurs ne se demandent pas pour l’instant comment une civilisation qui a produit ces fantastiques merveilles a pu en arriver à pourrir universellement la planète. Ils se tournent résolument et avec enthousiasme vers l’avenir car ils ont peur de regarder en arrière.
Il y a eu de l’histoire, mais il n’y en a plus
On trouve sous la plume de Karl Marx la thèse selon laquelle « nous ne connaissons qu’une seule science, celle de l’histoire4 ». L’histoire recèle précisément la solution d’une énigme qui n’intéresse pas les collapsologues. Cette histoire, ils sont bien décidés à s’en passer, à n’en tirer aucun enseignement. Voici comment ils l’évacuent :
Retrouver le sol, le terrestre, implique aussi de retrouver notre histoire commune avec les autres habitants de la planète. […] Pour retracer l’histoire de l’apparition de la vie, ramenons ces 4,5 milliards d’années à une année de calendrier. […] La révolution industrielle, celle qui nous préoccupe tant […] représente la toute dernière seconde de cette année cosmique. […] Ce récit permet de revoir entièrement notre manière très anthropocentrée de raconter l’Histoire (avec un grand H mais dans une petite seconde)5.
Ainsi, pour citer une nouvelle fois Marx, dans Misère de la philosophie, qui se moquait déjà des penseurs bourgeois de la fin de l’histoire, « il y avait de l’histoire, et maintenant il n’y en a plus ! ». Les raisons profondes – historiques, politiques et sociales – de l’effondrement sont minorées au profit des causes immédiates – physiques et écologiques – qui viennent conforter la prophétie. Comme l’a rappelé Elisabeth Lagasse, pour donner un crédit scientifique à l’idée d’effondrement,
les collapsologues s’en réfèrent généralement à des données quantitatives, issues des sciences naturelles. Ce faisant, ils effectuent un glissement entre les sciences naturelles et les sciences sociales, en étudiant la société comme un « écosystème », et en déduisant de données « physiques » un effondrement social6.
Or, cette façon d’aborder les problèmes en faisant dériver les déterminismes sociaux des lois de la nature porte un nom, poursuit Lagasse : « le positivisme ».
Positivisme qui, sous prétexte d’objectivité scientifique, en vient à naturaliser en fait l’ordre social existant, c’est-à-dire à neutraliser la charge critique qu’implique le constat du désastre pour la société actuelle au profit de la prophétie scientifique sur l’effondrement. Ce à quoi nous sommes confrontés, ce sont en effet des predicaments, autrement dit des situations inextricables qui ne seront jamais résolues, comme la mort ou une maladie incurable. Pour répondre à l’angoisse qu’ils ont contribué à créer, nos effondrementalistes s’appuient alors sur un travail réalisé autour de la maladie de Huntington. Il s’agit d’une maladie dégénérative héréditaire, rare et incurable, qui se révèle généralement vers les quarante ans et peut entraîner une mort rapide. Un certain nombre d’idées ont été formulées à son propos concernant la manière la plus appropriée d’annoncer la mauvaise nouvelle et de vivre avec elle.
Le problème est que la « maladie » dont nous souffrons n’est pas « héréditaire » ou « génétique », c’est-à-dire « naturelle » : elle est historique, sociale et politique. Car quelle est la cause principale de la catastrophe grandissante ? La croissance à tout prix, résultat de la concurrence pour le profit maximum. Par conséquent, si on veut trouver un point de comparaison dans le domaine médical, ce n’est pas une maladie génétique qu’il faut choisir, mais une maladie provoquée par la course au profit. L’asbestose, fibrose pulmonaire due à l’inhalation prolongée de poussière d’amiante, constituerait donc un meilleur exemple. Or, qu’ont fait les victimes de cette maladie ? Se sont-elles résignées à leur sort ? Non, elles se sont mobilisées avec acharnement contre les entreprises de l’amiante parce que celles-ci les ont empoisonnées, en pleine connaissance de cause, pendant des décennies et avec la complicité des gouvernements. Dans ce contexte, « arrêter de se battre7 » (contre la maladie) signifie rien moins que capituler face à l’exploitation, tendre l’autre joue en se résignant à l’injustice8.
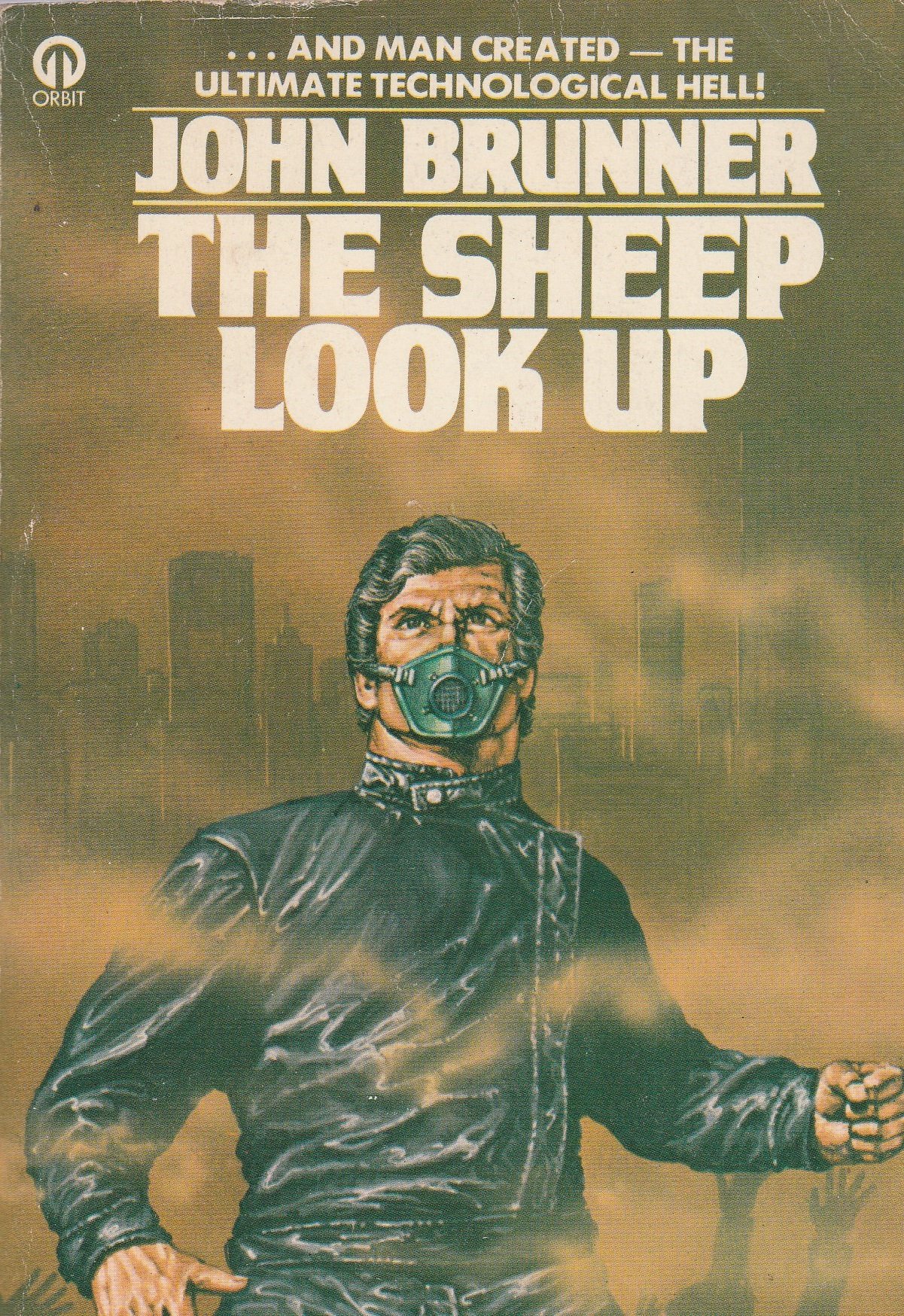
Dans une tribune au journal Le Monde, du 23 juillet 2019, Agnès Sinaï, Pablo Servigne, et Yves Cochet exposent de manière très synthétique leur conception de l’effondrement. Sur les causes qui vont inéluctablement le faire advenir, on peut lire ceci :
Ainsi, l’effondrement est inévitable non parce que la connaissance scientifique de son advenue est trop incertaine, mais parce que la psychologie sociale qui habite les humains ne leur permettra probablement pas de prendre les bonnes décisions, au bon moment.
Voilà une belle manière de naturaliser le capitalisme ! Les structures de pouvoir, l’État, les entreprises, les institutions, les classes sociales, l’économie, l’industrie et la dynamique du marché, etc., tout cela s’efface soudain. Non, c’est juste un défaut dans la « nature humaine » qui est responsable du désastre. Ce sont simplement « les humains » (les dirigeants ?) qui ne sont pas capables de prendre les « bonnes décisions » dans une situation trop complexe. Et ce n’est là que « l’expression de caractéristiques banales de l’espèce humaine lorsqu’un événement extraordinaire s’annonce » (article cité). Autrement dit, non seulement la domination n’est pas le problème, mais elle aurait même pu être la solution si seulement elle avait été encore moins dépendante de la « nature humaine », c’est-à-dire encore plus impersonnelle, froide et calculatrice.
Adaptez-vous !
Les effondrementalistes privilégient la notion de résilience d’un système au détriment de toute forme de résistance individuelle ou collective. L’idée de résilience, définie comme la capacité à se remettre d’un choc extérieur, sur lequel on n’a pas prise, sous-entend que l’origine et les responsables de ce bouleversement finalement importent peu, ce qui importe étant de survivre. Ainsi il ne s’agit pas de « résister au changement ou de vouloir nécessairement retrouver le même état », lit-on dans Une autre fin du monde est possible. L’essentiel est plutôt de « rebondir en s’ouvrant à la possibilité de se transformer pour ne pas perdre certaines de ses fonctions » (les auteurs soulignent). En d’autres termes, le « système » doit avant tout « gérer », en termes d’inputs et d’outputs, ce qui lui arrive sans faire intervenir les sentiments, le vécu, la signification des événements autrement que comme « variables d’ajustement ». Nous sommes là devant une pensée cybernétique, c’est-à-dire le langage de la domination, ici mis à l’usage des dominés, où la seule perspective consiste à survivre et s’adapter.
En ce sens, la collapsologie est une forme nouvelle du progressisme, au sens de l’attitude qui attend de l’avenir la solution des maux du présent. Cette fois, c’est l’effondrement de la société marchande et industrielle qui va nous – du moins, les survivants – obliger à être vertueux écologiquement. Et comme pour le Progrès, qu’on ne peut pas plus arrêter que l’effondrement, il faut dès maintenant s’y préparer. On a parfois l’impression d’une idéologie de cadres, enjoignant à tout un chacun de s’adapter. Cela ne signifie pas seulement se conformer à l’ordre des choses existant, mais surtout anticiper l’évolution future et agir dès maintenant en conséquence9. Comme l’avait vu naguère Jaime Semprun,
l’attente d’une catastrophe, d’un auto-effondrement libérateur du système technique, n’est que le reflet inversé de celle qui compte sur ce même système technique pour faire venir positivement la possibilité d’une émancipation : dans l’un et l’autre cas, on se dissimule le fait qu’ont justement disparu sous l’action du conditionnement technique les individus qui auraient l’usage de cette possibilité, ou de cette occasion ; on s’épargne donc à soi-même l’effort d’en être un10.
Effectivement, ce qui se dégage de ce discours effondrementaliste, ce n’est pas un appel à la liberté, mais simplement à la survie, quelle que soit la manière dont les choses tournent ensuite. Puisque pour nos scientifiques, la liberté et l’oppression ne sont pas des variables quantifiables, des notions mathématisables, tout au plus pourrait-on évaluer leur efficacité. Ainsi, disent-ils,
avec le niveau ahurissant de complexité de nos immenses sociétés, il y a de quoi se poser la question de la pertinence de telles architectures [hiérarchiques] de pouvoir. Non seulement elles nous rendent bien plus vulnérables et moins résilients en cas de grandes perturbations […] mais, par leur rigidité, elles sont devenues des facteurs d’aggravation des catastrophes.
Volontiers amenés à éclairer ceux qui nous gouvernent, au motif que dans n’importe quelle catastrophe industrielle ou écologique particulière comme avec l’effondrement général de la civilisation, « nous avons besoin de tout le monde » et « nous sommes tous sur le même bateau », les collapsologues répètent à l’envi que ceux qui s’offusqueraient d’une telle unanimité ou ne la souhaiteraient pas, se priveraient « de pans entiers de la vie. C’est-à-dire en premier lieu de la survie11. » Autrement dit : qui critique, conteste et résiste sera abandonné à son triste sort. On ne saurait dire plus clairement que les trois auteurs privilégient avant tout la survie et l’adaptation, au détriment de la lutte contre les fauteurs de désastre.
Les étranges rituels de la transition intérieure
Ne voulant surtout pas analyser les causes socio-politiques du désastre en cours, et encore moins influer sur elles – persuadés que leur prophétie scientifique va se réaliser – les collapsologues se tournent résolument vers eux-mêmes, vers les sentiments que leur inspire l’effondrement à venir, la subjectivité et les affects qu’ils génèrent chez les convertis.
En effet, dans leur dernier ouvrage, Servigne, Chapelle et Stevens se focalisent sur ce que ressentent les individus face à l’annonce de la prophétie de l’effondrement avec une approche écopsychologique et narcissique où les réponses collectives et les luttes ne sont là que comme décors pour ce théâtre d’ombres. Pour eux, « ne pas annoncer que “tout est foutu”12 » signifie qu’il faut avant tout « passer par un processus de deuil » du monde existant et par une « transition intérieure » afin de se préparer à ce qui est présenté comme inéluctable. Depuis leur premier ouvrage, la foi en l’Effondrement, la certitude scientifique de son inéluctabilité sont le ciment de tout un ensemble de nouveaux croyants13. Les groupes de discussion sur l’effondrement et les moyens d’y faire face se multiplient sur les réseaux sociaux. Et si l’on ne peut que se réjouir que des personnes, prenant conscience du désastre écologique que constitue la société capitaliste et industrielle, changent complètement de vie et cessent de participer autant que possible à cette société, le caractère très dépolitisé de la collapsologie n’amène pas nécessairement à une plus grande lucidité sur ce système.
« Quand on voit qu’on détruit la planète et que les gouvernements ne font rien, on se dit que tout va s’écrouler un jour », expose calmement Amélie, 38 ans, entre deux bouchées de purée maison. (Le Monde du 5 février 2019).
Pas plus qu’ils ne se posaient hier de questions sur l’origine du Progrès, les nouveaux convertis ne s’en posent aujourd’hui sur les causes de l’Effondrement, trop occupés qu’ils sont à préparer la seule chose qui leur importe, leur salut dans l’au-delà ; c’est-à-dire leur avenir après l’effondrement – lequel risque fort de reproduire les mêmes tares que le présent.
Ayant, comme on l’a vu, aboli l’histoire sociale au profit de l’histoire naturelle, les collapsologues se penchent sur la « nature humaine » telle que l’a analysée le psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875-1961). Pour Jung, plus un groupe humain est développé, plus il a refoulé ses racines primitives, sauvages et barbares. Or, celles-ci sont sources de vitalité et de créativité. Chaque peuple doit les retrouver pour les assumer, faute de quoi les « archétypes » resurgiraient violemment, hors de tout contrôle. Soit une conception très essentialiste de la « nature humaine » et de l’« âme des peuples » qui se prête aisément à diverses dérives mystiques et racistes. Il semble que Servigne, Chapelle et Stevens soient arrivés à Jung notamment en lisant certaines auteures écoféministes. En accord avec la naturalisation des rapports sociaux qui est un de leurs réflexes caractéristiques, nos effondrementalistes semblent s’être limités à cette variété d’écoféministes qui essentialisent les différences entre hommes et femmes. Estimant que « les hommes souffrent aussi de la blessure secrète du patriarcat », ils plaident pour la « réconciliation hommes-femmes » et nous invitent à pratiquer à cet effet des « rituels initiatiques ».
Sur ce point, on reste passablement intrigué à la lecture du déroulement des week-ends d’initiation du « nouveau guerrier » (New Warrior Training Adventure) organisés par le ManKind Project. Ce ManKind Project est un business mis sur pied par trois américains à l’initiative d’un certain Bill Kauth, psychothérapeute jungien. Ce dernier définit son projet comme une réponse à la vague féministe des années 1980. Impressionné par le potentiel émancipateur des groupements féministes, Kauth décida de mettre sur pied des groupes non mixtes censés permettre aux hommes aussi de se libérer. Le ManKind Project a manifestement pour but de neutraliser l’inquiétude que suscitent les mouvements féministes chez certains hommes en exaltant les « vertus masculines ». En fait, il pourrait n’être rien d’autre qu’une branche du mouvement masculiniste.
Plus loin, les auteurs appellent à des alliances entre les BAD – Bases Autonomes Durables, popularisées par le survivaliste d’extrême droite Piero San Giorgio et son livre Survivre à l’effondrement économique[^14] (cité sans plus de précision quant aux accointances politiques de l’auteur) – et les ZAD – Zones À Défendre telle que Notre-Dame-des-Landes – sans que l’incompatibilité manifeste entre ces deux formes de projet politique saute aux yeux de nos collapsologues. Les ZAD sont basées sur la confrontation pour se libérer, les BAD sur la fuite pour se replier14. Que le phénomène survivaliste touche aujourd’hui un public bien plus large que les libertariens ne constitue pas vraiment une bonne nouvelle. Il s’agit avant tout d’un énorme marché en pleine expansion, une sphère où se croisent désormais « bobos et fachos » qui offre une tribune discrète mais importante (10 000 personnes lors du deuxième salon du survivalisme, du 22 au 24 mars 2019 à Paris) à des individus et organisations d’extrême droite15.
Si les effondrementalistes veulent par là insister sur le fait que « nous sommes tous dans le même bateau » il nous faut constater que cela commence déjà à sentir la pourriture dans les cales de ce navire16, avant même qu’il soit en perdition…
Une réappropriation par quels moyens ?
Si l’on prend au sérieux la prophétie collapsologique, il devrait être évident que ce ne sont pas seulement les jardins ou les cités en permaculture qui permettront d’y survivre. Tout l’enjeu, exprimé dans Comment tout peut s’effondrer, consiste alors à s’organiser pour « retrouver les savoirs et les techniques qui permettent de reprendre possession de nos moyens de subsistance avant de pouvoir se débrancher [du système industriel]. Les chemins de l’autonomie sont dès lors collectifs17 ». Collectifs, mais pas politiques. Dans ce passage sur une des « politiques de l’effondrement » possible, les auteurs signalent ensuite que David Holmgren, « co-créateur du concept de permaculture », a proposé de se débrancher du système industriel aussi vite que possible. Au-delà des spéculations plus ou moins hasardeuses sur la capacité à susciter un effondrement par boycott, cette « politique du grand débranchement » s’apparente à l’idée de réappropriation de la subsistance que nous défendons par ailleurs18. Mais les auteurs ne semblent pas saisir son importance pratique dans une « politique de l’effondrement » qui tienne compte des nécessités vulgairement matérielles de la survie. Cette idée disparaît complètement de leur dernier ouvrage au profit de choses plus douteuses.
Dans une section hallucinante intitulée « Une mobilisation… comme en temps de guerre », ils déclarent sans rire :
 Photographie de l’astronaute Alan Shepard Jr., le 5 mai 1961 (AP Photo).
Photographie de l’astronaute Alan Shepard Jr., le 5 mai 1961 (AP Photo).
Il y a une réelle urgence et la taille de l’enjeu est immense. […] Alors pourquoi ne pas déclencher un gigantesque effort de guerre, comme lorsque les Alliés et l’URSS ont vaincu les Nazis ? Pourquoi ne pas lancer de grands projets Manhattan [nom du programme de construction de la bombe atomique lors de la Seconde Guerre mondiale], mais sous forme de milliers de petits projets low tech et avec des fins de désarmement ? Pourquoi ne pas organiser des « grands débarquements » destinés à stopper la désertification en reboisant massivement ? (p. 178-179).
Ici, les auteurs ne semblent pas se souvenir qu’il y avait aussi de « grands récits » et des « leaders charismatiques » dans l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et du côté de l’impérialisme japonais qui ont mobilisé de grandes masses d’hommes où « vibrait le sens du sacrifice, de l’héroïsme, de la défense des valeurs sacrées, d’une identité, d’un territoire, etc. ». Ils ignorent en outre que ce que le « monde libre » défendait là, ce n’était pas la liberté et l’égalité mais seulement « la liberté du commerce et de l’industrie ». Par ailleurs, ils soulignent :
Dans les années 1940, et grâce à un formidable effort de guerre, les États-Unis sont parvenus à renoncer un moment à la culture de consommation et du gaspillage. En 1943, les “Victory Gardens” mobilisaient plus de 20 millions d’Américains et produisaient 30 à 40 % des légumes du pays ! Le recyclage, le covoiturage et même le rationnement furent la règle aux États-Unis pendant quelques années.
Néanmoins, si le gouvernement des États-Unis a obligé ses citoyens à « renoncer un moment à la culture de consommation et du gaspillage », n’est-ce pas avant tout afin de soutenir « la culture de consommation et du gaspillage » des militaires lors d’une guerre à l’échelle mondiale ! Aujourd’hui, le même principe est mobilisé dans la propagande en faveur du greenwashing : les « petits gestes écocitoyens » mis en avant, à travers le tri des déchets et la « consommation responsable », permettent justement à l’industrie du recyclage de se développer sur la base de ce travail fantôme (ce qu’Ivan Illich désignait comme le complément non rétribué des activités marchandes) et ouvrent la création de nouveaux « marchés verts », sans qu’à aucun moment ne soit remise en question la croissance économique indéfinie ; c’est-à-dire la guerre mondiale contre le vivant. Bien qu’à un moment ils évoquent la principale contradiction qu’implique une telle « mobilisation générale », à savoir que ce sont aussi ses moyens même, le pétrole et les machines, qui sont les ennemis à abattre, ils passent outre ce petit problème trivialement pratique et bassement matériel aussi vite qu’ils le mentionnent.
Une ultime confusion sur l’idée d’effondrement
Au-delà des ouvrages des collapsologues, l’idée même d’effondrement est problématique.

Derrière cette idée, sont en fait confondues deux choses très différentes. D’une part, la dégradation continue des conditions de la vie humaine autant que naturelle, qui sont constitutives de notre existence libre et autonome, sous l’effet de l’expansion prédatrice du capitalisme industriel. Et d’autre part, l’effondrement de la société capitaliste et industrielle sous l’effet de la raréfaction des ressources fossiles nécessaires à la production de marchandises dont actuellement nous dépendons largement pour notre existence. Les effondrementalistes amalgament ces deux problèmes – au prétexte que dans les deux cas c’est notre existence qui est menacée –, comme si le premier et le second étaient nécessairement liés. Or l’analyse critique du capitalisme industriel montre précisément que la valorisation marchande se réalise essentiellement grâce à une artificialisation croissante de l’existence humaine.
La conquête spatiale, où la survie immédiate de l’être humain est totalement dépendante d’une machinerie très complexe et donc de sa relation avec le système économique et technologique qui en assure le fonctionnement, est comme une sorte de modèle emblématique du capitalisme industriel19. La science-fiction a déjà abordé le thème de la survie de l’humanité alors que la dégradation des conditions d’une vie libre et de la nature atteint le stade terminal20. Tout cela devrait donc plutôt inciter à prendre au sérieux la formule de Walter Benjamin :
Il faut fonder le concept de Progrès sur l’idée de catastrophe. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe.
La catastrophe capitaliste pourrait bien continuer jusqu’au bout, jusqu’à la destruction totale de la nature, et à la mise sous perfusion marchande et industrielle de l’humanité – ou en tout cas d’une partie des survivants. Bien sûr, cela implique à plus ou moins longue échéance la fin de l’humanité, et donc celle du capitalisme. Que ce système coure ainsi à sa perte, qu’il sape les conditions mêmes de son existence, qu’il organise son auto-destruction, il n’en a que faire. Car « le capitalisme » n’est pas une personne qui réfléchit à la meilleure manière de prolonger son existence, mais bien un système qui fonctionne précisément grâce à l’inconscience de ses acteurs quant à la signification et aux conséquences de leurs actes ; lesquels se retournent régulièrement contre eux, pour le plus grand bénéfice du système dans son ensemble.
L’épuisement de la nature, la dégradation des ressources vitales et vivantes – celles qui permettent une vie libre aux êtres humains faits de chair et de sang – n’implique nullement la fin du système économique et technique, l’arrêt de la machinerie faite d’acier et d’hydrocarbures. Car les ressources fossiles et minières sont encore considérables et tout un tas d’ingénieurs s’emploient depuis longtemps déjà à synthétiser à partir de cela les éléments nutritifs indispensables à la vie biologique des êtres vivants21.
Cette foi en l’effondrement de la société capitaliste et industrielle du fait de son inconscience à propos de la limitation des ressources fossiles a amené l’ex-ministre vert et collapsologue Yves Cochet à déclarer : « Ce qui va tuer le capitalisme, c’est la géologie22 ! »
Déclaration particulièrement stupide, car il n’est pas besoin d’être un grand savant pour se souvenir que la croûte terrestre ne fait que quelques kilomètres et qu’en-dessous on trouve de la roche en fusion sur plusieurs milliers de kilomètres. La géothermie pourrait donc fournir une source d’énergie fossile quasiment inépuisable, pour peu que l’on parvienne à l’exploiter à une échelle industrielle.
 Extrait de The North American Indian d’Edward S. Curtis. Library of Congress, c. 1914
Extrait de The North American Indian d’Edward S. Curtis. Library of Congress, c. 1914
Autre exemple, avancé par l’historien Jean-Baptiste Fressoz : la fonte de la banquise Arctique du fait du changement climatique non seulement ouvre le passage du Nord-Est à la navigation commerciale, raccourcissant le trajet de l’Europe vers le Japon et la Chine et inversement, mais surtout va permettre la prospection et l’exploitation des réserves considérables d’hydrocarbures et d’autres ressources minières de cette région jusque-là difficilement accessible à cause du grand froid23. Loin de constituer une entrave au développement industriel, les conséquences désastreuses de la croissance économique pour la nature et pour la vie sur Terre ouvrent de nouveaux marchés, offrent de nouvelles opportunités. Bref, le capitalisme ne s’est jamais aussi bien porté, et il peut compter sur une armée d’ingénieurs pour trouver des solutions technologiques à l’épuisement de certaines ressources (le pétrole facile à extraire aussi bien que la production alimentaire).
Or les effondrementalistes semblent vouloir faire le pari exactement inverse : ils misent sur un effondrement relativement rapide du système économique et technologique qui laisserait le champ libre à l’humanité dans une nature pas encore trop abîmée. Ce pari nous semble pour le moins hasardeux, car personne ne sait vraiment ce que le sous-sol nous réserve ni ce dont est capable l’ingéniosité humaine pour maintenir les conditions d’une survie en milieu extrême.
Par contre, il est plus facile de savoir ce qui se passe à la surface de la Terre et ce que le système industriel inflige déjà, ici et maintenant, à la nature et aux êtres humains ; mais c’est précisément ce que les effondrementalistes ne veulent pas regarder en face, parce qu’ils devraient ainsi renoncer à l’illusion que la société dans laquelle ils vivent et se trouvent si bien constitue un Progrès inégalé dans l’histoire de l’humanité.
C’est pourquoi ils préfèrent imaginer la fin de leur monde plutôt que de concevoir la fin du capitalisme.
Conclusion
À l’opposé de ceux qui croient trouver dans la « collapsologie » l’expression d’une critique radicale nécessaire pour relever le gant de la catastrophe grandissante, l’effondrementalisme prêche au contraire la résignation, l’attente de l’événement purificateur et rédempteur qui – obligeant tout le monde à se serrer les coudes face à l’adversité – épargnerait à chacun de devoir comprendre, identifier et lutter contre les mécanismes socio-politiques de la guerre contre la liberté humaine et contre l’autonomie du vivant actuellement en cours. La « renaissance » que les collapsologues espèrent voir sortir finalement de l’effondrement a donc de grandes chances d’être surtout une régression archaïque vers des structures de pouvoir toujours plus coercitives.
Bref, comme le monde de la marchandise dont il est issu, l’effondrementalisme prétend délivrer chacun de la politique, c’est-à-dire d’avoir à penser personnellement et agir collectivement dans la perspective d’établir un monde meilleur, ici et maintenant.
Bertrand Louart
-
Donella Meadows, Denis Meadows, Jorgen Randers, Les Limites à la croissance (dans un monde fini) [1972], Éditions Rue de l’échiquier, 2012. On lira avec plus de profit l’ouvrage du philosophe Bernard Charbonneau, écrit entre 1950 et 1967, Le Système et le chaos : critique du développement exponentiel, Éditions Anthropos, 1973. ↩
-
Céline Pessis, Sezin Topçu, Christophe Bonneuil, (dir.), Une autre histoire des « Trente Glorieuses » : modernisation, contestation et pollutions dans la France d’après-guerre, La Découverte, 2013. ↩
-
Pierre-Henri Castel, Le Mal qui vient : essai hâtif sur la fin des temps, les Éditions du Cerf, 2018, ironise sur le fait « qu’il paraît bien tôt pour faire une science de la fin du monde » et trouve plus approprié la dénomination « effondrementalisme » qui désigne une forme d’idéologie. ↩
-
Karl Marx, L’Idéologie allemande, 1ère partie, Éditions Sociales, 1972, p. 55. ↩
-
Servigne, Chapelle, Stevens, Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre), Seuil, 2018, p. 218-220. ↩
-
Elisabeth Lagasse, « Contre l’effondrement, pour une pensée radicale des mondes possibles » article en ligne sur le site Contretemps, revue de critique communiste, 18 juillet 2018, www.contretemps.eu/ ↩
-
Servigne, Chapelle, Stevens, op.cit., 2018, p. 61. ↩
-
Ce passage sur la maladie doit beaucoup à l’article de Daniel Tanuro, « La plongée des “collapsologues” dans la régression archaïque », article en ligne sur le site Contretemps, revue de critique communiste, 6 mars 2019, www.contretemps.eu/ ↩
-
Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter » : sur un nouvel impératif politique, Gallimard, 2019. Cet ouvrage montre bien comment l’idée d’adaptation, issue de l’évolutionnisme darwinien, est devenue un nouvel impératif néolibéral, la croissance économique et l’innovation technologique étant inéluctables. Les institutions – et l’État en premier lieu – se doivent non seulement d’encourager cette adaptation chez les individus, mais surtout préparer la société par des mesures et une politique adéquate. ↩
-
Jaime Semprun, L’Abîme se repeuple, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 1997. ↩
-
Servigne, Chapelle, Stevens, op. cit., 2018. ↩
-
Servigne, Chapelle, Stevens, op. cit., 2018, p. 62. ↩
-
Voir la série d’articles de Cécile Bouanchaud et d’Audrey Garric, « Du “coup de massue” à la “renaissance”, comment les collapsologues se préparent à la fin de notre monde », « Le succès inattendu des théories de l’effondrement », « En un été, on a vendu la maison, la bagnole, et on est partis », Le Monde du 5 février 2019. Cyprien Tasset, « Les “effondrés anonymes” ? S’associer autour d’un constat de dépassement des limites planétaires », La Pensée écologique, vol. 3, n° 3, 2019.14. Piero San Giorgio, Michel Drac, Survivre à l’effondrement économique : édition de combat, Le retour aux sources, 2011. Livre numérique gratuit. ↩
-
Cf. Evan Osnos, « Lorsque les ultra-riches se préparent au pire. Reportage chez les survivalistes de la Silicon Valley » [The New Yorker, janvier 2017], Revue du Crieur, n° 7, juin 2017. ↩
-
Les auteurs peuvent également consacrer plusieurs pages aux thèses sur l’effondrement de l’ingénieur russo-américain Dmitry Orlov sans mentionner que ce personnage est un complotiste réactionnaire et xénophobe. Voir Comment tout peut s’effondrer, p. 187-192. ↩
-
« Effondrement, le début de la fin », Libération, 7 novembre 2018, et Jean-Baptiste Fressoz, « L’effondrement des civilisations est un problème qui obsède l’Occident depuis au moins deux siècles », Le Monde, 23 juillet 2019. ↩
-
Servigne, Stevens, op. cit., p. 241-242. ↩
-
Voir Bertrand Louart, La Réappropriation contre le progrès, Éditions la Lenteur, 2020 (à paraître). ↩
-
Lewis Mumford l’avait déjà souligné dans Le Mythe de la machine. Vol. 2, Le Pentagone de la puissance, 1974. Ill. 14-15, « L’Homme encapsulé ». ↩
-
Voir notamment le roman de John Brunner, Le Troupeau aveugle, R. Laffont, 1975 ou le film de Richard Fleischer, Soleil vert, 1973. Comme les transhumanistes, les collapsologues semblent ignorer que la science-fiction a déjà brodé sur leurs fantasmes de manière parfois plus fructueuse qu’eux-mêmes… ↩
-
Voir les récents progrès de la viande in vitro et d’autres cultures hydroponiques, toutes présentées comme hautement écologiques et respectueuses des êtres vivants par rapport aux productions animales et végétales de l’agro-industrie. ↩
-
Yves Cochet et Anne Rumin, « Qu’est-ce que la collapsologie ? », vidéo sur YouTube, 15 octobre 2018. ↩
-
Jean-Baptiste Fressoz, « Iamal ou “la fin du monde” », tribune dans Le Monde, 25 septembre 2018.Bertrand Louart est menuisier ébéniste à Longo Maï (Alpes-de-Haute-Provence), rédacteur de Notes & morceaux choisis. Bulletin de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle.Site internet : Et vous n’avez encore rien vu… critique de la science et du scientisme ordinaire.Dernier ouvrage paru : Les Êtres vivants ne sont pas des machines, Éditions la Lenteur, 2018. ↩
Collapsologie et survivalisme Faire de la fin du monde une brèche
